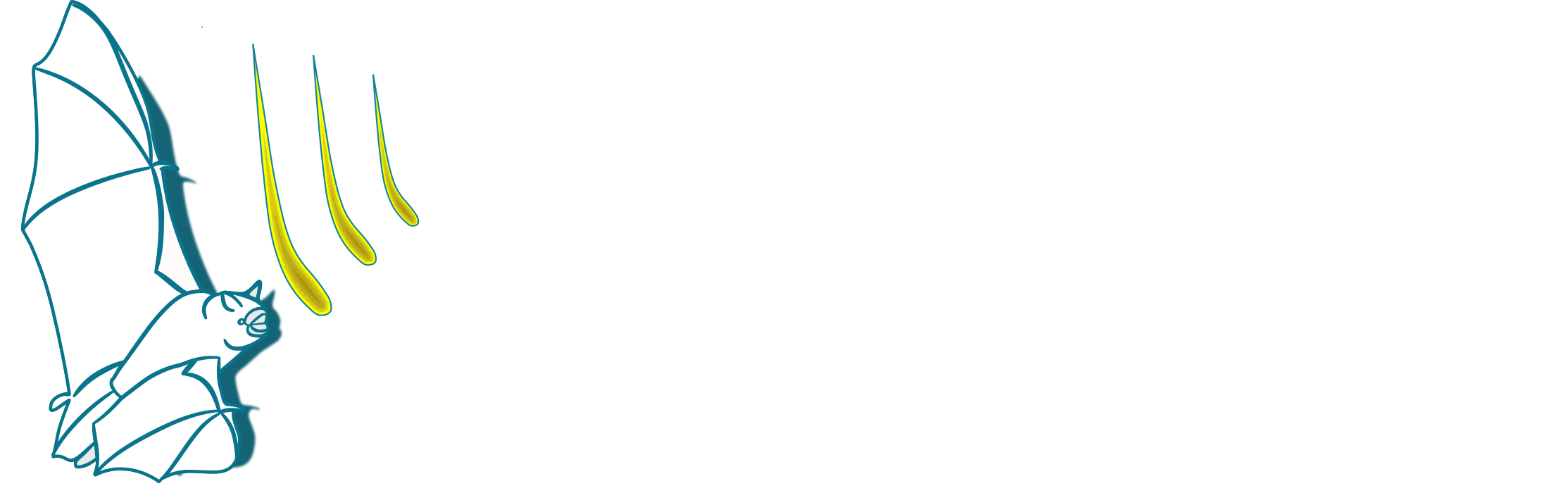Trames Vertes Routières sur le réseau viaire de la Région Guadeloupe
Le projet de Trames Vertes Routières est étroitement lié à la notion de continuités écologiques. Celles-ci sont définies comme un ensemble de zones vitales pour une population d’espèces (réservoirs de biodiversité) et d’éléments permettant aux individus de circuler entre ces zones (corridors écologiques). Les composantes terrestres et aquatiques de ces continuités sont généralement regroupées sous le nom de trames verte et bleue (TVB). Elles traduisent la synergie fonctionnelle entre différentes composantes des milieux naturels.
À ces continuités se greffent d’autres trames liées aux conditions rencontrées par les animaux sur différents secteurs de leur domaine vital. Les paramètres les plus impactants pour la majorité des espèces sont la lumière et le bruit. Les zones préservées de la pollution lumineuse, nuisible aux espèces lucifuges ou photophiles, sont qualifiées de trame noire. Les milieux où les intensités sonores sont compatibles avec le maintien des populations sont qualifiés de trame blanche.
Il convient enfin de rappeler que les animaux se déplacent en trois dimensions et non pas uniquement dans le plan horizontal que nous utilisons habituellement pour nos représentations cartographiques. Les espèces volantes ou fouisseuses peuvent ainsi rencontrer des barrières peu intuitives telles que des éoliennes, des lignes électriques ou encore des réseaux enterrés.
En raison de leur géométrie intrinsèquement linéaire, les infrastructures routières sont souvent à l’origine de ruptures de continuités écologiques. En fragmentant les écosystèmes, les routes affectent les habitats naturels et la faune sauvage de manière disproportionnée par rapport à l’emprise de la voirie. Les points de conflit entre le réseau viaire et les corridors écologiques se traduisent par un panel d’effets directs et indirects.
Le plus évident est sans doute la mortalité, laquelle affecte tous les groupes faunistiques. Le nombre d’individus perdus suite aux collisions peut s’avérer important, au point de mettre en péril la pérennité de populations fragiles et/ou très vulnérables à certains stades de leur cycle de vie. Associée aux diverses nuisances émanant des voies de circulation (pollutions lumineuse, sonore et chimique), la mortalité directe contribue fortement à l’effet barrière associé aux infrastructures linéaires de transport. Lorsqu’il est intense, celui-ci est à même d’entraver les processus de dispersion et de colonisation. Les conséquences de cet isolement sur la génétique des populations peuvent être fortes.
Longtemps ignorées mais désormais bien documentées, de telles incidences appellent à une évolution de la « culture de la route » en matière d’aménagement et d’entretien. Cette prise de conscience a conduit à l’émergence du concept de dépendances vertes. Le terme fait référence aux milieux de transition entre la chaussée et le paysage environnant. Il peut désigner une grande diversité de typologies végétales : pelouses rases, communautés prairiales, linéaires de haies, patchs forestiers, zones humides, etc. Correctement conçues et gérées de façon équilibrée, les dépendances vertes peuvent constituer d’importants lieux d’expression de la biodiversité, y compris en reconnectant des populations totalement ou partiellement isolées.
Le diagnostic réalisé en 2021 dans le cadre de l’établissement du Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (SRPNB 2021-2030 – ONF-Région Guadeloupe, 2021) a mis en évidence les secteurs de ruptures des continuités écologiques dans l’archipel.
Le secteur de l’agglomération centre est le plus dégradé. Les zones urbanisées et agricoles se sont largement développées au détriment des réservoirs de la trame verte. Les infrastructures de transport, routières ou aériennes, fragmentent les quelques corridors naturels qui se maintiennent difficilement. Pourtant, l’isthme entre la Basse-Terre et la Grande-Terre constitue une zone clé pour le déplacement des animaux.

Vue schématique des principaux corridors linéaires et des grands ensembles de perméabilité vis-à-vis de la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Source Diagnostic SRPNB Guadeloupe (ONF, 2021)
Certains travaux récents ont mis en évidence des différences morphologiques et génétiques entre des populations d’oiseaux de la Basse-Terre et de la Grande-Terre. Il apparaît ainsi que l’altération des continuités écologiques entre les deux îles réduit les flux de gènes entre les populations (Arnoux et al. 2013, 2014 ; Khimoun et al. 2016). Les résultats les plus significatifs de ces recherches concernent des espèces à tendance forestière, mais sont aussi notables pour des espèces plus ubiquistes.
Restaurer des continuités écologiques terrestres identiques à celles qui existaient originellement dans le secteur de la conurbation pointoise n’est malheureusement pas un objectif réaliste. De façon plus pragmatique, une part de la solution pourrait résider dans l’adaptation d’infrastructures existantes, dans le but de créer une nouvelle trame apte à constituer un support de déplacement pour certaines espèces. De par son omniprésence et sa configuration extrêmement maillée, le réseau viaire constitue pour cela un bon candidat.
C’est dans cette logique d’adaptation que s’insère le projet de Trames Vertes Routières (TVR) porté par la Région Guadeloupe. Sans prétendre compenser intégralement les ruptures de continuités actuelles, il propose de requalifier écologiquement les espaces associés à la route dans l’optique d’une certaine réappropriation du territoire par la faune locale.

Localisation des quatre tronçons de Trames Vertes Routières étudiés dans l’état initial faune-flore
Cinq tronçons de routes nationales de l’agglomération centre ont été retenus pour la première phase des Trames Vertes Routières, dont quatre ont pu être intégrés dans l’étude d’état initial :
- Aéroport/Providence (RN11) ;
- Jaille/Fond Sarail (RN11) ;
- Convenance/Arnouville/Daubin (RN1) ;
- échangeur de Versailles/Trinité (RN1).
Treize stations d’étude ont été sélectionnées pour représenter la diversité des conditions le long des différents tronçons ainsi que celle des futures plantations.



Quelques exemples de stations échantillonnées dans le cadre de l’état initial
Les inventaires floristiques ont recensé 61 espèces au sein des neuf habitats identifiés. Trois de ces habitats sont notés comme patrimoniaux malgré leur état dégradé (ripisylves, forêt semi-décidue sur calcaire et forêt marécageuse).
Parmi les plantes observées, 29 sont des espèces indigènes et une seule (Montrichardia arborescens) présente un statut NT (quasi-menacé, UICN 2019). Cette espèce est indicatrice d’un état pionnier de la mangrove. Les espèces arborées et arbustives totalisent 16 espèces indigènes, principalement observées en bord de route.
Les inventaires faunistiques ont recensé 81 espèces d’insectes, 26 espèces d’oiseaux, huit espèces de Chiroptères, quatre espèces d’amphibiens et deux espèces de reptiles. Ces espèces sont pour la grande majorité communes voire très communes. Les introduites sont globalement abondantes et largement réparties, de même que quelques espèces indigènes affectionnant les milieux anthropisés.
Parmi les espèces présentant un intérêt patrimonial jugé modéré ou supérieur, une seule est associée à un enjeu de conservation très fort : le Chiroderme de Guadeloupe (Chiroderma improvisum). Cette espèce n’a été détectée qu’à une seule reprise, en bordure de RN1 et à environ 250 m au nord de l’échangeur de Versailles. Les autres espèces ont un intérêt patrimonial au mieux modéré. Celles-ci incluent le Pigeon à couronne blanche (Patagioenas leucocephala), l’Ardops des Petites Antilles (Ardops nichollsi), le Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus) et l’Éleuthérodactyle de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis).
Rappelons cependant que certaines espèces communes en Guadeloupe, et présentant donc un intérêt patrimonial souvent considéré comme faible, connaissent un déclin de leurs populations.

Gecko demi-deuil (Lepidodactylus lugubris) sous l’écorce soulevée d’un mahogany-petites-feuilles

Éleuthérodactyle de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis) temporairement posé sur une glissière en béton
Si les plantations des Trames Vertes Routières devaient s’avérer efficaces en termes de continuités écologiques, elles pourraient favoriser la dispersion de l’ensemble des taxons mobiles à cette échelle paysagère. Cela concerne à la fois des espèces à fort enjeu de conservation, des espèces indigènes communes et des espèces introduites. Les suivis post-plantations récemment engagés s’attachent donc à évaluer l’évolution des communautés faunistiques de manière à conclure sur l’apport de la TVR en termes de biodiversité.
Depuis cette étude d’état initial, la croissance des plantations s’est avérée particulièrement impressionante sur l’ensemble des secteurs de la TVR. D’autres zones ont également été sélectionnées pour poursuivre les efforts de recréation de trames à plus grande échelle sur le patrimoine routier de la Région Guadeloupe.
Étude co-réalisée par ACSES, AcoNat, Levesque Birding Enterprise, Tauai Flora et Toni Jourdan




commanditée par la Région Guadeloupe