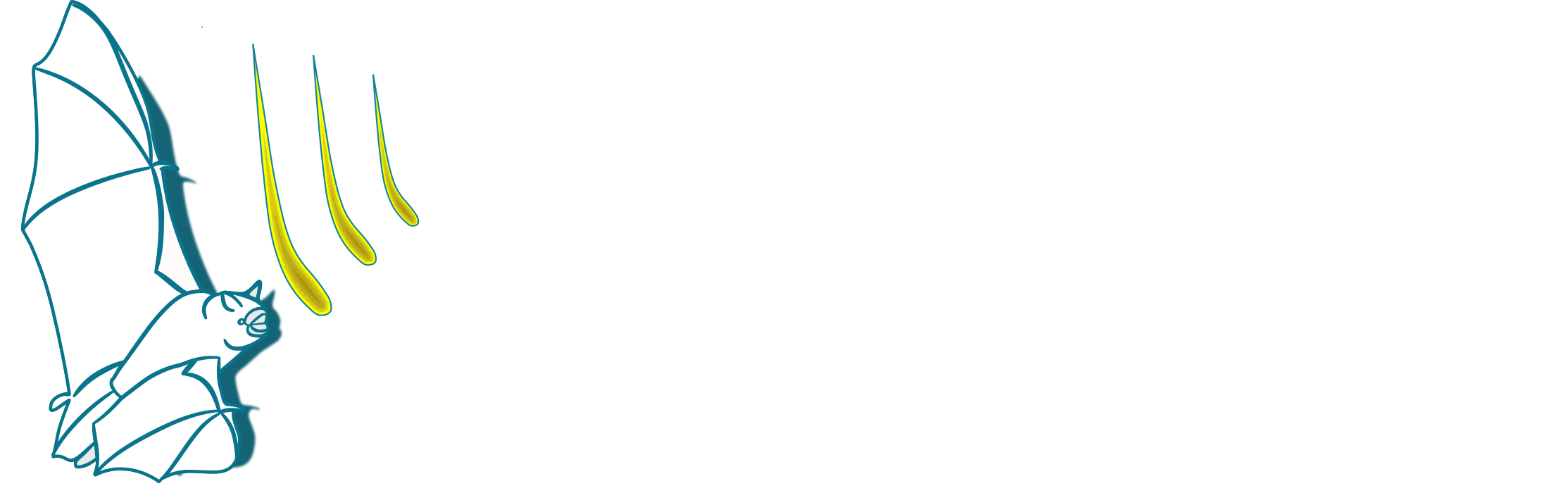Prise en compte des Chiroptères dans les projets d’aménagement en Guadeloupe – Analyses et recommandations méthodologiques pour les prospections acoustiques
L’inventaire du cortège chiroptérologique est un préalable à la prise en compte des chauves-souris dans un projet d’aménagement. Les chiroptérologues disposent de diverses méthodologies pour la mise en œuvre de leurs prospections de terrain. Capture au filet, recherche visuelle et détection acoustique en sont les principaux exemples. Les modalités pratiques de ces approches sont radicalement différentes et leurs résultats souvent complémentaires.

Dans l’hexagone, l’utilisation de la méthode acoustique pour la reconnaissance spécifique des Chiroptères a principalement été initiée à partir des années 1990 par les travaux de Michel Barataud et de ses collaborateurs. La transposition de cette technique dans les Antilles françaises est plus récente, consacrée par l’article de Barataud et al. (2015) sur l’identification et l’écologie acoustique des Chiroptères de Guadeloupe et de Martinique. Plusieurs méthodes ont été développées à partir de ce socle fondateur. Elles ont en commun une certaine facilité d’application pour un opérateur formé. Leur principal atout est par ailleurs leur caractère non intrusif pour les animaux.

Les clés d’identification, graphiques, spectrogrammes et autres éléments d’interprétation de l’article de Bartaud et al. (2015) consistuent une base indispensable pour l’étude acoustique des Chiroptères des Antilles françaises.
Séquence de Molosse commun (Molossus molossus) écoutée en hétérodyne, détecteur réglé sur 40 kHz.
Séquence de Molosse commun (Molossus molossus) et de Fer de lance (Artibeus sp.) écoutée en expansion de temps par 10.

Cri d’écholocation du Brachyphylle des Antilles (Brachyphylla cavernarum) visualisé sous forme de spectrogramme sur le logiciel BatSound (Pettersson AB)
L’écoute active consiste à capter les séquences de Chiroptères « en temps réel » à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. L’utilisation complémentaire de l’hétérodyne et de l’expansion de temps par 10 permet souvent d’identifier directement l’espèce à l’origine du train de signaux. Les séquences douteuses sont enregistrées puis analysées à l’aide de logiciels spécifiques pour tenter une identification jusqu’à l’espèce. Cette approche a pour avantage d’optimiser la perception du comportement des chauves-souris sur le terrain. En outre, elle permet de limiter le temps nécessaire au traitement des séquences, un grand nombre d’identification étant réalisées in situ. Les compétences nécessaires à son application sont néanmoins relativement longues à acquérir et nécessitent un rafraîchissement régulier. Il est par ailleurs peu envisageable pour un opérateur seul de procéder à une nuit d’écoute complète, et encore moins à plusieurs nuits successives.
L’enregistrement passif consiste à implanter un enregistreur automatique en un point choisi. Les nombreuses séquences collectées chaque nuit sont analysées postérieurement, le plus souvent à l’aide d’un logiciel de classification automatique. Cette méthode aboutit à une description plus complète de l’activité. D’un point de vue théorique, l’enregistrement passif doit également faciliter la détection d’espèces rares et/ou erratiques en maximisant le temps d’écoute. Le dépouillement des séquences a posteriori est plus accessible que leur détermination « instantanée » sur le terrain. Le contrôle rigoureux des identifications automatiques est toutefois chronophage et la quantité d’erreurs peut être importante. Lorsqu’ils sont dûment pris en compte par un chiroptérologue expérimenté, ces points faibles sont contrebalancés par la capacité des appareils à récolter une quantité importante de données, sur des durées supérieures et dans des conditions plus rudes que celles acceptables pour un être humain.

Enregistreur passif implanté sur le terrain, paramétré pour enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris.
Il existe à ce jour peu de lignes directrices sur les protocoles de recherche acoustique des Chiroptères dans le cadre de projets d’aménagement. L’émission de recommandations adaptées au territoire serait donc un apport considérable pour une meilleure prise en compte des Chiroptères dans les projets en Guadeloupe. Cette étude avait donc pour objectif d’identifier des paramètres méthodologiques optimisant l’efficacité des prospections acoustiques pour l’évaluation de la richesse spécifique. La complémentarité entre les méthodes active et passive a également été testée. L’analyse a porté sur les résultats de plus de 100 points d’écoute active et sur plus de 60 nuits d’enregistrement passif.
Les paramètres testés pour l’écoute active étaient : la durée unitaire des points d’écoute et la durée d’écoute cumulée, la durée moyenne d’écoute unitaire et cumulée avant détection des espèces, la relation entre le type d’habitat, la richesse spécifique et la durée d’écoute unitaire ou cumulée, l’heure de début des points d’écoute, la saisonnalité des points d’écoute.
Pour l’écoute passive, il s’agissait de tester les paramètres suivants : le nombre de nuits d’enregistrement, le nombre moyen de nuits avant détection des espèces, la relation entre le type d’habitat, la richesse spécifique et le nombre de nuits d’enregistrement.
Parmi les paramètres non testés, citons le niveau d’activité, la hauteur des microphones (consultez notre article à ce sujet pour en apprendre plus) et la typologie de projets.

À la lumière de nos résultats, les points d’écoute active devraient être conduits sur une durée minimale de 15 min, préférentiellement de 20 min et idéalement de 30 min. Cette durée étendue est particulièrement pertinente pour tenter de mettre en évidence des espèces peu communes dans des habitats a priori pauvres en espèces. Plusieurs points d’écoute sont à prévoir sur chaque station ou au sein chaque site, de manière à cumuler une durée d’écoute minimale de 90 min et idéalement de 100 min ou plus.

Accumulation de la richesse spécifique moyenne (Smoy) des points d’écoute de 60 min (n = 10) et évolution du rapport entre Smoy et la richesse spécifique moyenne au terme des points d’écoute (Smax 60’)

Accumulation de la richesse spécifique moyenne (Smoy) pour 90 min d’écoute cumulée (n = 26) et évolution du rapport entre Smoy et la richesse spécifique moyenne au terme des 90 min (Smax 90’)
L’heure de début des points d’écoute semble avoir peu d’impact sur la richesse spécifique recensée dans un intervalle horaire compris entre 1h et 5h après le coucher du soleil. Nous recommandons cependant de varier l’heure de début de points d’écoute entre les différents passages. Des écoutes actives au crépuscule, en début de nuit ou même en fin de nuit peuvent apporter des informations différentes telles que la localisation de corridors entre les gîtes et les zones d’alimentation.
La saison humide apparaît globalement plus favorable à la détection d’un grand nombre d’espèces pour une durée d’écoute active fixe.

Distribution statistique des richesses spécifiques recensées sur 46 points d’écoute réalisés sur les mêmes stations en saisons sèche et humide. Les valeurs chiffrées indiquent la moyenne.
Dans le cadre d’enregistrements passifs, le cumul de trois nuits complètes semble constituer un minimum pour aboutir à un cortège relativement stable. Lorsque les enjeux potentiels sont forts, par exemple en cas de présence supposée d’une espèce très patrimoniale, il peut être justifié de procéder à une ou plusieurs nuits supplémentaires.
Nos données mettent en évidence la complémentarité entre l’écoute active et les enregistrements passifs. Ce constat souligne encore davantage l’intérêt des deux méthodes. Chacune présente sans conteste des points forts et des limites qui leur sont propres. Lorsqu’elles sont judicieusement combinées, elles permettent de réunir des informations clés pour juger de l’importance d’un site pour les Chiroptères.

Distribution statistique des richesses spécifiques obtenues après 1, 2, 3, 4 et 5 nuits d’enregistrement passif. Valeurs chiffrées = richesse spécifique moyenne.

Contribution de chaque méthode au nombre d’occurrence par espèce
Il convient enfin de rappeler que la détection acoustique ne peut être toujours considérée suffisante pour l’étude des Chiroptères dans le cadre d’un projet d’aménagement. La mise en œuvre d’autres protocoles tels que la détection visuelle ou la capture peut dans certains cas s’avérer pertinente voire nécessaire, par exemple lorsque la présence d’espèces difficilement détectables en acoustique est supposée (ex : Chiroderma improvisum, Sturnira thomasi, Natalus stramineus). Dans chaque rapport d’étude, nous invitons les chiroptérologues à justifier leurs choix méthodologiques afin de permettre aux services instructeurs de juger de leur adéquation avec les enjeux pressentis au sein de la zone d’étude.
Étude réalisée par AcoNat, dans le cadre d’un groupement avec L’ASFA et Naturalia Environnement



commanditée par la DEAL Guadeloupe